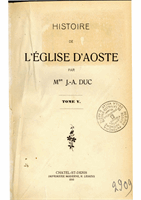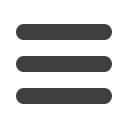
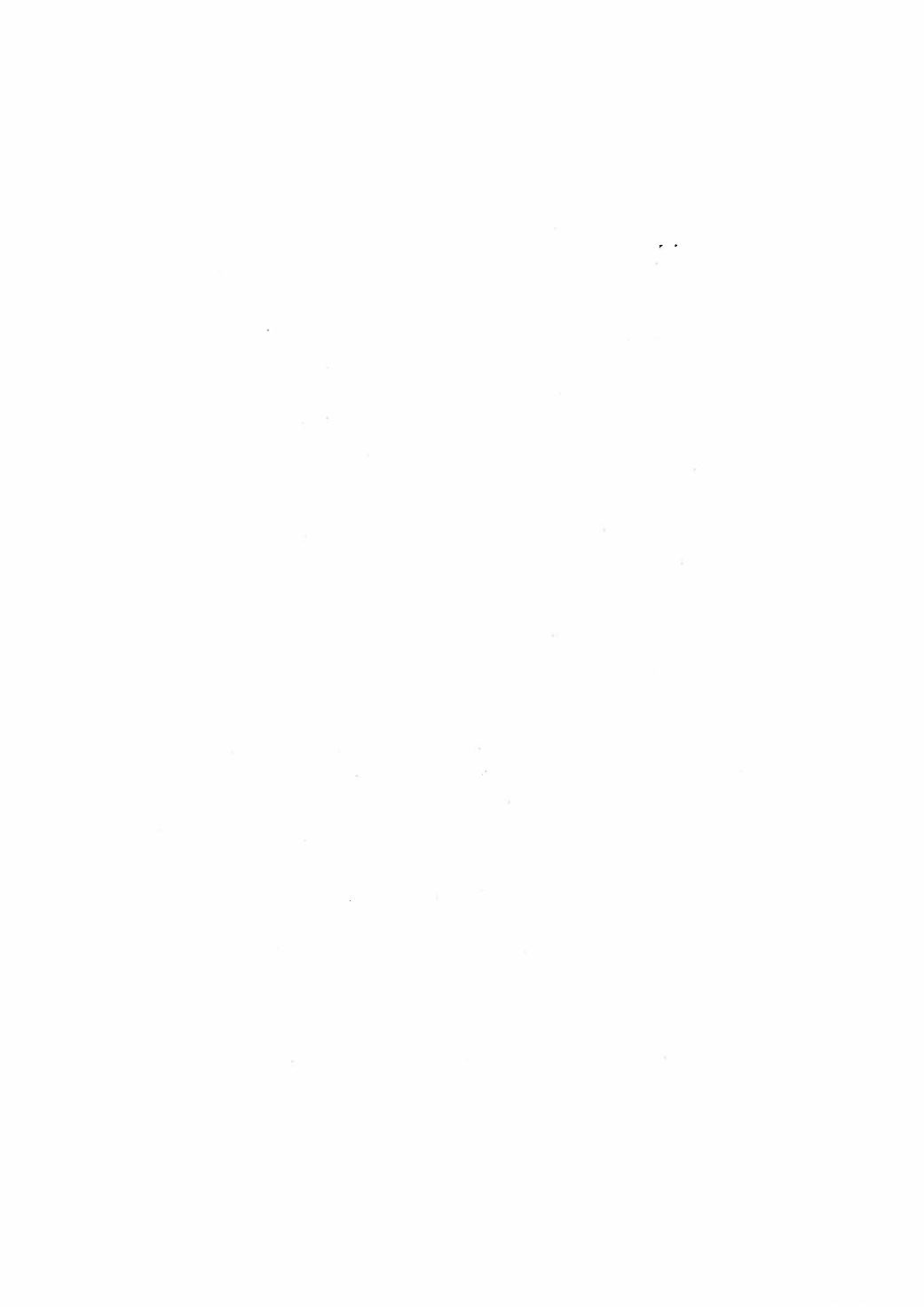
382
HISTOI RE DE L 1ËGLISE 01AOSTE
.C'est l e
1 2
avr i l
1 553
que l e duc Charles engea en
haronn i e le m andement de Valleise en faveur du sei
gneur Antoine et de ses fils.
Le clergé réun i en synode, le
31
août, choi sit pour
ses procureurs Pantaléon Rosset, curé de Sa i nt-jean ,
François Marti net, curé de Gressan , Hugonet Cognen
chi� curé de Sai nt-Vi ncent, Benoît Jacod, recteur de
l 'hôpital de La $alle, Bri ce Lyabe l , admodiateur du
pr i euré de Sainte-Hél ène , et André Bal , vicaire de
Sa i nt-l?ierre. Il s'agissa it de dirimer la controverse
.
encore pendante touchant l a succession des prêtres que
réclamait Mgr Gazin. I l -faut remarquer que l ' évêque ,
s elon l e l angage de l 'Egl ise, étan t J e père de ses prê
tres, devai t recuei l l i r leur hér itage ; c'était le principe
reçu dans beaucoup de diocèses. Etaient exceptés l es
chano i nes de l a Cathédrale, auxquels, s'ils moura i ent
ab intestat,
succédait
�
e chapitre, vigueur d'un usage
approuvé par Alexandre
IH
et confirmé par Léon X, en
date du
1 0
j anvi er
i 51 4.
Le cl ergé sécul ier du di ocèset
contrairement aux prétenti ons�de Mgr Gaz i n , s 'appuyait
mr l a coutume . En cet état de choses, l es procureurs
nommés et l 'évêque convi n rent de soumettre la question
i
un arbitrage. De commun accord, on élut pour arbit res
Jean Ginod
·
official, Jean Louis Vu l liet archidiacre et
joffred Gi nod, tous les trois do cteurs ès-droits. En défi
n i tive , i l fut décidé que les prêtres sécul i ers étaient par
faitement l ibres de disposer de l eur fortune, tant entre
vifs que par testament , en l aissant toutefois
à
l ' évêque
l a somme de c i nq petits fl orins. Quan t aux b i ens des
prêtres
morts
ab intestat,
ils devaient être dévolus à